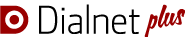Resumen de Apport de l'étude des handicaps langagiers à la connaissance du langage humain
Jean Luc Nespoulous, Jacques Virbel
Cet article vise à illustrer une approche du handicap langagier selon deux lignes de force principales: d'une part, l�apport de l�étude du handicap à la connaissance du langage humain dans sa généralité et d'autre part, l�apport mutuel, dans une conception interdisciplinaire dynamique, des sciences du langage, de l�information et de la communication. On met tout d�abord en évidence l�existence de dysfonctionnements langagiers �centraux� et �périphériques�, et les stratégies palliatives que les sujets sont amenés à développer dans les deux cas. L�examen de ces stratégies est riche d�enseignements sur l�exercice du langage dans sa plasticité, son dynamisme, et son caractère non-stéréotypé. Les dysfonctionnements périphériques sont ensuite l�objet d�une présentation de recherches et de réalisations de palliatifs technologiques. On met en particulier en évidence les problèmes de fond cependant posés ici, au-delà d�une visée applicative à courte vue: de nombreux concepts, - à commencer par celui de �handicap� lui-même -, doivent être refondés, et des questions telles que celle de la substitution sémiologique ou celle de l�équivalence sémantique s�avèrent centrales. La dernière partie est consacrée à l�illustration de l�intérêt qu�il peut y avoir à rapporter ces réflexions à des conceptions cognitives de la communication et de l�information langagières. Celles-ci, en mettant en évidence la complexité du processus de communication dans sa généralité (selon par ex. la théorie des actes de langage), contribue à insérer le handicap dans un vaste éventail d�échecs communicationnels potentiels, et à beaucoup relativiser l�acception courante de l�opposition �normal�/pathologique. Par le fait, le handicap se trouve aussi inséré dans un large éventail de recherches sur la communication humaine.
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados