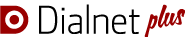Resumen de Se repérer à Lyon à l’époque moderne. Habitants, consuls et cartographes
Olivier Zeller, Bernard Gauthiez
Longtemps, tout repérage reposa à Lyon sur des systèmes tacites de définition. Les plans ne proposaient que des didascalies résultant de choix symboliques. Les noms de rues étaient abandonnés à des usages populaires multiples et fluctuants. Paroissiaux ou miliciens, les découpages internes ne donnaient lieu à aucun marquage sur le terrain, les quartiers restant longtemps désignés par le nom de leur capitaine ou par des références géographiques variables. La définition des adresses reposait sur la connaissance des propriétaires car la multiplicité des enseignes au thème identique rendait problèmatique leur rôle de repère, sauf dans le cas des grandes auberges. Nul système de numérotation des maisons ne fut rendu visible ; les référencements appliqués à partir de 1723 appartenaient à une culture administrative interne.
Consécutif au traumatisme des grandes émeutes, le souci de nommer les espaces et de publier des limites n’apparut qu’après 1744-1745. Une gravure définissant enfin les quartiers fut massivement diffusée, puis les odonymes envahirent les plans de la ville. Ils furent fixés en 1755 par la pose de centaines de plaques. Ainsi s’accomplit le passage de pratiques de repérage mobilisant une culture urbaine tacite à une lecture dénominative fondée sur le recours à l’écrit exposé.
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados