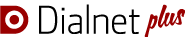"J'écris, donc je suis": Schreiben als Überlebenskunst in Jean-Paul Sartres Roman "La nausée"
- Autores: Kurt Hahn
- Localización: Romanische Forschungen, ISSN-e 1864-0737, Vol. 121, Nº. 4, 2009, págs. 454-476
- Idioma: alemán
- Enlaces
-
Resumen
La pensée du premier Michel Foucault a longtemps passé pour la mise à mort de l'existentialisme et de sa conception du sujet comme conscience autonome. Pour nuancer la distinction simpliste, la critique récente vise à repérer les parallèles entre le »pro-jet« sartrien et la production discursive du sujet chez Foucault. Loin de vérifier ce rapprochement d'un point de vue philosophique, l'article présent propose un double changement de perspective en appliquant les réflexions du dernier Foucault sur les »pratiques de soi« antiques au texte littéraire de Sartre. Il est notamment question de son premier roman La nausée (1938) que l'on a souvent réduit à une anticipation fictive de L'être et le néant (1943). Au contraire, les observations suivantes envisagent La nausée comme un roman de l'écriture dans lequel disparaissent successivement les téléologies de l'Histoire, de l'Amour et de la Littérature salvatrice. Etant donné cet effacement des grands récits, le protagoniste Antoine Roquentin vit une crise profonde qui risque d'aboutir à l'isolement pathologique et à la perte de soi. Afin d'y faire face, il tient un journal où, malgré tout, il s'affirme comme sujet, s'effectuant et s'affectant par le processus scriptural. Vu sous cet angle, Roquentin actualise une »écriture de soi« (Foucault), même si ce ne sont plus que des fragments personnels qui se dessinent dans ses notes. »L'art de l'existence« décrit par Foucault réapparaît donc dans La nausée comme »art de survivre«, dans la mesure où l'articulation du journal constitue pour Roquentin le dernier refuge contre la contingence qui le hante et le mine de l'intérieur.
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados