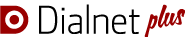L'Altérité du Logos: Image parfaite au sein de la Trinité
-
-
[1] Universidade Católica de Pernambuco
Universidade Católica de Pernambuco
Brasil
-
- Localización: Teoliterária, ISSN-e 2236-9937, Vol. 9, Nº. 17, 2019 (Ejemplar dedicado a: Mística e Literatura), págs. 49-69
- Idioma: francés
- Enlaces
-
Resumen
La signification inscrite dans une image est polyvalente. L’image peut à la fois raconter une histoire et agir comme le portrait d’une personne. Il est toujours possible qu’une autre interprétation excède l’intention de l’acte créateur d’une image. Cela peut nous aider à franchir le chemin des théories de l’image, quand il s’agit de l’identité religieuse. Dans cette perspective, le christianisme apparaît, en quelque sorte, comme une synthèse entre l’idolâtrie païenne et l’aniconisme juif et musulman, du fait que l’utilisation d’images et la critique de leur culte devient l’affrontement entre la religion de l’irreprésentable et l’idolâtrie de la représentation. En effet, l’utilisation d’images dans les lieux de culte sera l’origine d’un désaccord entre les trois religions monothéistes, à l’égard du paganisme associé à une telle pratique. En ce sens, au-delà de l’inadéquation des représentations, nous désirons analyser l’arrière-plan d’une rationalité théologique à l’œuvre dans l’histoire, notamment chez Saint Augustin et d’autres Pères de l’Église et qui font écho dans nos jours. En conséquence, les philosophes et les théologiens médiévaux vont souvent se demander : Pouvons-nous connaître quelque chose sans images ? Toute image est-elle trompeuse ? Est-il licite de faire une image de l’Absolu ? D’après quoi pourrions-nous imaginer Dieu ?
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados