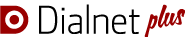Marques d'oralité et représentation de l'oral en français
Información General
- Autores: Marta Saiz Sánchez (coord.), Amalia Rodríguez Somolinos (coord.), Sonia Gómez-Jordana Ferary (coord.)
- Editores: Université de Savoie
- Año de publicación: 2020
- País: Francia
- Idioma: francés
- ISBN: 9782377410149
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
Resumen
Cet ouvrage recueille des contributions qui étudient les marques linguistiques propres à la langue orale ainsi que la représentation des phénomènes oraux dans des supports écrits. Les contributions s'organisent en trois parties, les deux premières –la représentation de l’oral à l’écrit et les marqueurs du discours oral– portent sur le français contemporain. La dernière aborde la représentation de l’oral soit en français médiéval, soit dans une diachronie plus longue. Les approches théoriques et méthodologiques diverses permettent de décrire la langue orale dans toutes ses facettes discursives, aussi bien en tant que variante diamésique phonique opposée à la langue écrite –dans les textes littéraires, les forum, les sms, etc.–, qu’en tant que variante diastratique caractérisant le parler familier de certains groupes sociaux ou en tant que variante conceptionnelle positionnant le discours sur un axe immédiateté / distance communicative.
La variété des corpus analysés et les différentes approches théoriques permettent d’aborder la problématique de l’oralité sous divers angles. L’étude de l’oralité et de la représentation de l’oral se trouve actuellement au centre de la recherche en linguistique. Le volume réunit des études très différentes qui témoignent de l’ampleur du domaine.
Otros catálogos
Listado de artículos
-
págs. 19-42

págs. 43-66

págs. 67-86

Les marques d’oralité dans les pratiques écrites: du roman parlant du début du XXe siècle aux écrits connectés
págs. 87-106

págs. 107-126

págs. 127-148

págs. 149-162

La représentation de l’interlocuteur: le cas du marqueur je sais
págs. 163-172

págs. 173-188

De la représentation de l’oral au marquage de l’interactivité: les interjections euh et heu dans le corpus 88milSMS
págs. 189-204

págs. 205-222

Naviguer dans le dialogue et faire voir ce que l’on dit: approches linguistique et psycholinguistique de voilà
págs. 223-246

págs. 247-266

págs. 267-290

Voire voire et nennil nennil !: À la recherche des premiers marqueurs rédupliqués en français médiéval
págs. 291-312

págs. 313-344

págs. 345-366

págs. 367-386

© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados